
Les Belvédères
Il y a eu cette promenade heureuse, sur les belvédères de la Haute Somme, à l’automne finissant, avec ses infimes rougeoiements. Le village d’Eclusier, dans ses nuances de l’ambre, celui de Frise ensuite, avec l’histoire de son romancier suisse, soldat captif dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale et « herborisant » sous la canonnade, enfin Cappy, pour terminer la boucle, sous un soleil pâlot.
Vaux revisité avec bonheur, mais avec ce petit rien d’abandon éprouvé. Deux ou trois pêcheurs s’égrènent sur les berges endormies, au bord de la route. La modeste bourgade est noyée sous la brume, vidée de ses hommes. J’ai envie de secouer cette torpeur froide et vaporeuse, redonner un petit coup de tison à la fin de saison, remettre un peu de dorure aux bras nus des arbres. L’église sévère est comme engoncée, derrière sa montagne de craie. La guérite de l’éclusier est déserte.
L’automne jette ses dernières nuances, dans l’immensité trouble des marais, prépare aux frimas, aux attentes lancinantes. L’hiver, bientôt, imprimera ses cendres froides. L’hôtel restaurant de « La Petite Folie », pleure aussi ses goûteurs de vie. On n’y mange plus désormais les anguilles fumées… À cause d’un meurtre, paraît-il… le fils passant à l’acte et tuant le père. Œdipe réécrit, par un matin lugubre et brumeux, ou peut-être un soir, lorsque les ombres s’étirent sur l’eau fangeuse des étangs. J’imagine les silences, les « noms dits », les querelles dérisoires autour du comptoir, les ferments de jalousie et de haine, la force éruptive, la malédiction implacable. Fin de l’acte, je n’irai pas plus loin dans la recherche des mobiles.
Je mets le cap vers le Belvédère, par la petite route de Suzanne, puis par l’allée qui fend le bois de Vaux. Le promontoire et sa chapelle, sur les pentes escarpées de la Somme ; c’est la promesse d’avoir la plus belle part de la vallée encaissée, où le fleuve - plutôt un bras mort - n’en finit pas de se vautrer avec complaisance, à travers les marécages et les rectangles d’eau. Je devrais dire une plaine d’eau, un delta, avec ses artères, ses avenues, ses ruelles étroites frangées de taillis, qui se perdent dans les scintillements. Des miroirs, aux formes géométriques, qui renvoient l’image d’un ciel plombé. Ici, tout est signe, témoignage du passage des hommes. C’était le pays de la pêche et de la tourbe, source de chauffage. Traces infimes, prières, on vous le répète sur les panneaux tagués, comme une urgence à dire, avant l’extinction des forces.

C’est un réel plaisir de voir tout cela, ce paysage mis à nu, avec ses nuances rehaussées. Ici ou là, l’écorce argentée de quelques bouleaux, la rouille des roselières, de frêles peupliers, le feston d’une voie, tracée comme une diagonale. De cet automne mourant, il reste, quand même, comme le souvenir du bouquet final, du feu d’artifice attendu à la Saint-Jean, avec les feuilles des saules giclant au-dessus de l’eau ou bien ces carex, dits « têtes de nègre », déployant leur chevelure ébouriffée sur les berges graciles.
Au Belvédère, il y a aussi cette fragile traînée crayeuse, qui serpente à travers le « larris » protégé. Le sentier des Maguettes zigzague, comme pris d’ivresse, au milieu du tapis jauni et pentu. Il est à lui seul, une invitation à l’aventure. Sur un panneau encore, on tente de vous expliquer la précarité de la Montagne de Vaux, pâturée jadis, menacée par la colonisation d’arbustes indésirables. On vous certifie qu’à la belle saison, vous pourrez admirer les églantiers, la Marguerite, aux promesses de pétales, la Digitale jaune, l’Orchidée aussi. Le sentier semble se perdre vers un bois et le hameau de Fargny, paradis des pêcheurs aux blancs, muets. De l’autre côté de la rive, il y a Curlu et son église au chapeau pointu, qui incite à l’envol de l’oiseau. Il y a Frise aussi, plus à l’est, qui implore votre attention. Pourquoi l’ignorer ? Ses points de vue semblent aussi beaux. J’y vais de ce pas, il n’y aura pas de jaloux.
Je quitte mon riant coteau calcaire où viendront paître, aux beaux jours, des bêtes pastorales. Le sentier de la Voyette, en dévers, s’incline abruptement vers Vaux. Place de l’Arrivoir, le silence est prégnant. Loin de tout, je suis comme le flâneur dérisoire. Je découvre le chaussée-barrage et son anguillère. Un droit de pêche depuis Napoléon. On y piège les civelles venues de la mer des Sargasses. Il y a cette brosse dérisoire pour les aider à passer l’obstacle. Je dérange en passant une poule d’eau qui se met à galoper sur les flots et fendre les nénuphars. Autour de moi, dans ce décor muet, des baraques, rafistolées avec des moyens de fortune, aux couleurs vives, rappellent le bon temps. Mais les saisons, ici, n’ont pas d’emprise sur les pêcheurs. Sur le quai, des barques, au mouillage, les attendent. Absents pour le moment, ils peuvent survenir à tout instant, dans leurs jambières vert prune.
De retour à Éclusier, par la route, au ras des étangs. Cela grouille de partout, cela pousse dans les îlots ; les buissons, les arbrisseaux essaient de renvoyer leur image dans l’eau cuivrée, chargée du limon des hauteurs environnantes. Peu après le village, sur la route de Frise, j’ai pris une sorte de sentier à l’estime, grimpant vers les hauteurs calcaires. A force d’emprunter cet endroit, on a façonné les marches. Tout la-haut, j’ai eu l’heureuse surprise de me retrouver sur le belvédère « concurrent ». Au-dessus de la barrière végétale, c’est quand même un avantage. J’ai revu Vaux, sa vallée dissymétrique et sa berge déferlante, colorées de pourpre, les franges de roseaux, les voies d’eau, les figures géométriques. Et tout en-bas du talus abrupt, une péniche fendant le canal de sa proue noire et agitant l’eau cuivrée de frissons.
« C’était le bout du monde et nous ne savions pas au juste où finissaient nos lignes et où commençaient les lignes allemandes, les deux tracés se perdant dans une prairie marécageuse plantée de jeunes peupliers jaunissants, maladifs et rabougris qui s’étendait jusqu’aux marais, où les lignes s’interrompaient forcément pour reprendre de l’autre côté de la vallée inondée et des méandres compliqués de la Somme, sur l’autre rive, à Curlu, haut perché, et au-delà. »
Blaise Cendrars « La Main Coupée »

C’est le bout du monde, en effet, impossible de ne pas convoquer Cendrars, l’auteur de « La Main Coupée », en découvrant les environs de Frise, recrus de guerres, en repensant à la vie de ces hommes taraudés par la haine et la peur. Comment oublier le récit épique du gramophone, piégé sur la colline du calvaire et déposé dans le « réseau des barbelés allemands », le « bois de la Vache », dans lequel le romancier tenait un poste avancé avec son compagnon Bikof. « C’était un sale coin » et pourtant ça avait l’air affreusement poétique. Les nuits sereines, interrompues par quelques détonations, le clair de lune, les « cris des oiseaux aquatiques », la « voie lointaine de la canonnade », le spectacle des « fusées éclairantes » Comment ne pas revivre non plus la cavale fantomatique de ces bateliers improvisés, sur les ondes silencieuses, seuls dans ces immenses étendues, parmi les saules, aux « branches contorsionnées », à la recherche de l’ennemi invisible, tapi sous les enroulements de brume.
À Frise, j’ai parcouru les lieux, cités dans l’œuvre. Le bois de la Vache, rabougri, les étangs de la Grenouillère, occupés par des campeurs. La rue Blaise-Cendrars avec son cimetière où dorment les civils et les militaires, les « pauvres petits pioupious en pantalons rouges garance, oubliés dans l’herbe. »
De ce village, paisible aujourd’hui, je n’ai que ces images grappillées, ces quelques flashes, les pêcheurs énigmatiques, le chenal rectiligne, de vieilles pommes rescapées, à vous tenter la main, la route sombre bordée du haut talus crayeux.
Avant de rentrer, j’ai fait une boucle à Cappy et griffonné ces modestes notes, sur mon calepin.
Le village semble couler des jours heureux, à l’écart des grands bruits. Une vie pastorale, presque, sur son versant abrupt, où court le beau sentier panoramique de Bray. Une vie sans doute de chasse et de pêche, autour des étangs, dans le respect du calendrier immuable, pour mieux survivre à la précarité de l’ennui. Un pays où l’on espère la bonne pêche, le brochet, combattu au bout de la ligne. Mais c’est l’histoire de la lutte que l’on retiendra, que l’on racontera, peut-être, au café « Chez Paulette », pour mieux la revivre.

Dans la salle sombre, mais chaleureuse, on se sent comme protégé du mauvais sort, vacciné par les piqûres d’amitié. On laisse passer sagement l’hiver et se succéder les jours. On attend les nouvelles promesses, les prises miraculeuses. Des hommes, assis au comptoir, sont immergés dans leur pays intime. Inutile de leur faire croire que le bonheur, ce sont les mers turquoise, le ciel bleu, les lagons mystérieux. Ils ne connaissent que l’eau ténébreuse des étangs, le bruit du courant déferlant au gué, le vol du héron cendré.
Je vous passe rapidement les détails, sur la placette bordée de charmes, sur l’église, avec ses quatre tourelles d’angle qui lui confèrent une allure martiale. Je vous évite la montée pénible, par la ruelle de la Procession, le long des vieux pans de mur brique et pierre, la maison aux volets bleu pastel. Je vous épargne mon discours sur le restaurant plus chic, aux menus gourmands.
Je n’insiste pas sur mon retour, laborieux, à Eclusier. J’avais choisi le côté plus sauvage du canal. Mal m’en a pris. Il faut apprendre à se perdre pour mieux se retrouver. J’ai lu ça quelque part, dans une narration de voyage. J’ai dû rebrousser chemin, non sans avoir insisté lourdement, sur des pontons scabreux, sur des passerelles de pêcheurs bricolées à la hâte, fendant les enchevêtrements des ronces et des roseaux. Je me suis résigné à emprunter l’autre chemin de halage. Il m’a réservé de belles surprises, il s’est montré généreux en sinuosités. L’automne a abattu ses dernières cartes, livré ses ultimes teintes d’ocre et de miel. Les bouleaux ont exhibé leurs jolis troncs délicats. Quelques pêcheurs extrémistes ont été surpris dans leur obstination à vouloir ferrer les mystères du chenal. Il n’y avait plus qu’à secouer les feuilles mortes en chemin et se laisser glisser.
J’ai retrouvé la maison d’Œdipe, mystérieuse, au pied de sa falaise de craie. L’ombre avait fini par s’installer. Sur la route de Péronne à Albert, il est un pays où la rivière a des envies vagabondes, où les belvédères sont posés comme des gradins, pour le plaisir des yeux. On pourrait manquer ces petits bonheurs. Dans ce pays luxuriant, il faut savoir lever le lièvre ou ferrer au bon moment.

« Une odeur me prend à la gorge
Forte, âcre, effluve violent,
À croire qu’un soufflet de forge
En pousse vers moi le relent.
Senteur de toute une contrée,
Sueur même de ce terroir,
C’est la tourbe, au printemps tirée
De l’entraille, immense miroir.
De ce brasier que je regarde,
Monte le songe pas à pas,
Fait d’un peu de terre picarde
Que je rapporte de là-bas »
Léon Devauchel (Archives Départementales de la Somme).
David DELANNOY
Ecrivain-marcheur.
Auteur de Lectures Buissonnières (Editions La Vague Verte) et de Picardie Vagabonde (éditions Punch - 30 textes illustrés d’aquarelles de Roger Noyon et de
Jean-Marc Agricola).
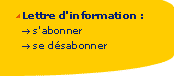


![]()
![]()








