
Je fais une étape à Long ce matin. Son église me décoche immanquablement sa jolie flèche de pierre. Je m’arrête devant ce que Robert Mallet appelait la récompense du jour, après ses longues virées en vélo, sur le chemin de halage.
« Il m’arrivait aussi de remonter le cour de la Somme depuis Pont-Rémy en direction d’Amiens. Je m’arrêtais à Long pour avoir, comme une récompense, la vision du château rose et blanc de Louis XV, l’un des plus distingués qui soient, dominant le paysage, au surplomb d’une terrasse. C’était exactement le paysage que Victor Hugo avait aimé, lorsqu’en 1837 il avait descendu la Somme d’Amiens à Abbeville en bateau à vapeur. »
Robert Mallet, Collection « Autrement »
Je maraude quelques regards à travers la grille ouvragée du manoir : un élégant pavillon aux harpes de pierre et son toit à la Mansart, qui coûta une folie au comte De Buissy.
Je poursuis ma quête sur le sentier crayeux et glissant ; il a ce talent de longer la rivière. Des peupliers droits comme des ifs m’ouvrent le passage. L’eau affleure la berge. Une libellule gracile fleurette parmi les herbes aquatiques, tenues en laisse et ondulant à la surface.

Une multitude de petites scènes plaisantes se succèdent au fil des pas. Je me dis que j’ai peut-être autour de moi les mêmes paysages rencontrés par l’impénitent promeneur Victor Hugo.
« … ce n’est qu’arbres, prés, herbages, et villages charmants. Mes yeux ont pris là un bain de verdure. Rien de grand, rien de sévère ; mais une multitude de petits tableaux charmants qui se suivent et se ressemblent ; l’eau coulant à rase bord entre deux berges de roseaux et de fleurs, des îles exquises, la rivière gracieusement tordue au milieu d’elles, et partout de petites prairies à herbe épaisse, avec de belles vaches pensives sur lesquelles un chaud rayon de soleil tombe entre les grand peupliers. »
Victor Hugo, « Lettres et Dessins de Picardie »
Je poursuis mon cheminement, observant des similitudes avec les scènes du passé. Des pêcheurs opiniâtres et taciturnes se sont joints aux vaches énigmatiques. Alentour, les mêmes sinuosités aimables, les échappées visuelles sur des prairies riantes.
A l’étang des Provisions ou à celui des Marais, peu importe, en bifurquant sur la droite, en direction de Lonpré-Les-Corps-Saints, l’espace s’ouvre soudain sur un univers plus vaste, ponctué de huttes au camouflage militaire mais adouci par la scène tranquille et harmonieuse de cygnes tuberculés.

Sur ces sentiers de hasard, tourbeux, bordés de roselières, j’ai ressenti toute la charge particulière des lieux, le poids des traditions. Je les ai peuplés de chasseurs à la hutte, immergés dans leur pays intime, tapis sous les feuillages, espérant les passages ailés, humant le silence bienfaisant. Je sais qu’ici on est attaché viscéralement à la solitude d’eau et de joncs qui s’étend entre les deux bords élevés de la Somme. Les passions, çà ne se discute pas.
Je continue ma marche en avant vers le passé. J’arpente, de long en large, une terre riche d’une belle histoire. Longtemps, de Long à Longpré, en passant par Le Catelet, des hommes simples se sont activés autour des bassins aux figures géométriques, pour y extraire la tourbe. Devant moi, un paysage façonné à la sueur des hommes, une terre noire, indélébilement attachée au passé, évoquant les vieux terrils du nord. Tout ici, la toponymie, les rectangles d’eau, la littérature renvoient à l’activité ancienne. Dans ce pays d’entailles, il en faudrait peu pour que viennent se greffer une légende, une mythologie de l’antique combustible aux applications multiples, des histoires à écrire, à raconter au coin du feu.
Dans son livre « La Semaine Sainte », Aragon, sensible au décor et aux odeurs de cette contrée, a décrit les « copeux », les « brouteux » acheminant les briquettes de tourbe jusqu’à « l’étente ». En ce temps là, la terre accordait ses offrandes avec parcimonie mais l’homme en tirait sa pitance. C’était du temps où les scènes se couvraient de panaches de fumerolles, à l’odeur acre, où les pyramides de briquettes avaient pour noms « catelets », « lanternes » ou « reuillets »…Des tableaux pittoresques pour les cartes postales au couleur sépia. Et pourtant malgré l’âpreté du labeur, on aimait ce pays.

On l’aime encore farouchement, pour les eaux moirées, ornées de roselières, pour les enclaves secrètes, pour les multiples voies d’eau, pour les pâtures inondées, pour les saules aux troncs éventrés, pour les baraques remplies de rêves de pêcheurs, pour les huttes entre ciel et terre, pour les promesses de plumes et d’écailles, les vols paraphant le ciel, les défilés des nuages, pour le mystère des étangs, les sauts carpés et luisants, pour le « floc floc » des bottes dans la terre spongieuse, pour le froufrou, le remue-ménage d’ailes dans les joncs, pour les silhouettes des bouleaux cendrés, les cimes argentés des peupliers, pour les reflets d’étain, les miroirs d’argent, pour le récital du vent, les attentes étoilées, le vin partagé, les mains frottées au-dessus du feu.
« … Le pays d’Eloy, c’était ici cette bande de prés noyés, hérissés de peupliers, coupés de canaux, d’étangs ; déjà, là-bas où les bras d’eau se perdaient à cinq cents toises environ peut-être, il n’était plus chez lui, et la Somme qui passait au loin, s’écartait moins d’une demi lieue du talus de sa rive gauche, à l’endroit le plus large de la vallée, mais c’était comme une autre région. »
« … Le pays d’Eloy, c’était cette brume et ces fumées basses, où l’on va à Flepes, c’est-à-dire en guenilles, avec pour seul douceur le lait de la vache, maigre et soufflante, qui paît dans les pacages inondés, les herbes trempées et les fleurs palustres. A peine y a-t-on pu se faire un bout de jardin, où les fèves vertes poussent moins bien que ces petits choux tout serrés qu’on rencontre tout le long de la Somme. Mais c’est le pays d’Eloy, comme la tourbe est son gagne-pain, comme Catherine est sa femme ; et il n’a jamais songé à les quitter, il ne discute pas. C’est son pays et sa vraie vie. C’est ici qu’il a grandi, qu’il a vu passer les saisons, usé sa force, eu froid et faim, c’est ici qu’il s’est terré avec la Catherine, qu’il l’a entendue crier, accouchant, année après année. Le poil lui a commencé à devenir blanc avant la quarantaine. Et il a été bien heureux encore d’avoir évité la conscription, quand ses frères ont été tués l’un pour la République, un second pour l’Empire, et on n’a plus jamais revu le déserteur, celui qu’il préférait, pour lequel il a appelé ce fils que voilà Jean-Baptiste. Ce n’est point qu’il ait oublié son enfance, qu’il revoit dans ses gamins, mais tout cela est si loin, loin comme Abbeville… »
La Semaine Sainte, Aragon
David DELANNOY
Ecrivain-marcheur.
Auteur de Lectures Buissonnières (Editions La Vague Verte) et de Picardie Vagabonde (éditions Punch - 30 textes illustrés d’aquarelles de Roger Noyon et de
Jean-Marc Agricola).
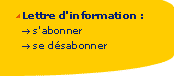


![]()
![]()







