Monsieur,
Je trouve que le texte de l’Association Terres des Écrivains sur l’insurrection des 5 et 6 juin privilégie par trop l’hypothèse de la provocation policière. Je vous envoie ci-après un extrait d’un texte sur la question :
Le convoi, parti de l’actuelle place de la Concorde, la place Louis XV, fit le trajet de la Madeleine, ensuite les boulevards, un détour par la colonne Vendôme et retour aux boulevards, les boulevards jusqu’à la Bastille et ensuite direction du pont d’Austerlitz.
On ignore si à l’arrivée les premiers coups de feu furent tirés par la troupe ou par les insurgés. On a vu ci-dessus Pelvilain et O’Reilly brandir des drapeaux rouges sur la place de la Bastille. Les dragons chargèrent mais quand et par qui les coups de feu furent-ils tirés ? Après coup, les forces de l’ordre rejetèrent le déclenchement des hostilités sur les insurgés et réciproquement. Faut-il croire le général Darriule, commandant de la place de Paris, lorsqu’il écrivait au maréchal Lobau, commandant de la garde nationale de Paris ? :
« … La marche du convoi se poursuivit rapidement et sans accidens graves jusqu’au pont d’Austerlitz. Là, près de l’estrade au pied de laquelle le cercueil avait été conduit, où des discours que je ne veux pas qualifier avaient été prononcés, parut tout à coup le drapeau rouge portant la devise la liberté ou la mort. Là fut présenté le bonnet rouge aux troupes indignées ; là les armes furent mises à découvert, et les cris au Panthéon ! au Panthéon ! mille fois répété avec fureur. Mais la garde municipale en s’opposant au passage, rue Buffon et rue Poliveau, assura le départ des restes du général. Les deux bataillons d’escorte, après les feux exécutés en l’honneur du mort, commencèrent leur mouvement de retraite sous les ordres du colonel Chatry de Lafosse, et rejoignirent sur la place de la Bastille le bataillon du 12e léger placé là en observation. Le 6e dragons, sur un avis du préfet de police, avait fait sortir deux escadrons. Arrivés à la hauteur de la caserne Sully, formés en colonnes par pelotons, et le sabre dans le fourreau, ces troupes rencontrèrent la voiture du général Lafayette, suivie d’une foule pressée, armée de fusils, de pistolets, de sabres et de poignards, et reçurent vingt ou trente coups de feu, dont furent atteints quelques hommes et plusieurs chevaux… » (17)
De toute manière, ce sont deux détachements successifs de dragons qui quittèrent la caserne des Célestins, les péripéties variant dans les deux cas.
La situation dégénéra ensuite. L’insurrection était lancée.
A en juger par le récit du général Darriule le déclenchement de l’insurrection aurait tenu à l’arrivée du 6e dragons mais les témoignages de Rèche (Reitz) et Poiret (Poirel), témoins au procès des insurgés Lépine et Thiellement, révèlent qu’à elle seule la Société gauloise, à supposer que la troupe n’ait pas tiré la première et n’ait pas provoqué le convoi à l’instar du 6e dragons, la Société gauloise donc aurait pris de toute manière l’initiative des combats. Voici ces témoignages :
« Il a été plusieurs fois question, dans les procès politiques, d’une association gauloise ayant pour but d’enrôler des ouvriers que l’on classait par centuries et décuries. Jean-Henri Lépine, signalé comme l’un des agens de cette société, s’est vu traduit aujourd’hui devant la première section de la Cour d’assises, présidée par M. Naudin. Les 3 et 4 juin, il révéla aux sieurs Rèche et Poiret à qui il venait de délivrer des brevets de décurion et de centurion, un complot qui ne devait pas tarder à éclater, et qui amènerait d’une manière infaillible la chute du gouvernement, parce qu’on y réunirait les mécontents de toutes les opinions. Il leur remit des cartes lithographiées, timbrées de cachets rouges, et portant ces mots : Patrie ; Association gauloise, et les engagea à les distribuer. Il leur donna aussi des balles de plomb ; il les pressa de se trouver au convoi du général Lamarque, et leur recommanda de se munir de deux épinglettes et de deux pierres à fusil, parce que le moment était pressant et qu’il ne fallait pas le laisser échapper. On devait, suivant lui, désarmer la troupe, proclamer la république sur la place de la Bastille, et se servir seulement du nom, mais nullement de la personne du général Lafayette, attendu qu’on ne voulait pas de lui. Lépine devait être membre du gouvernement provisoire. L’armée était gagnée, à l’exception des dragons et de la garde municipale, dont on espérait venir à bout en deux heures de temps. Enfin on devait donner à la légion marceline (c’est ainsi qu’il qualifiait la prétendue association gauloise) un drapeau ayant d’un côté cette inscription : vivre en travaillant, ou mourir en combattant ! et de l’autre : La liberté, ou la mort !… » (18)
: « … Reitz, serrurier, décoré de Juillet, rue de l’Arbalète, dépose : Le 13 mai, un camarade nommé Lépine m’a dit à moi et à mon ami Poirel qu’il faisait partie d’une société de mécontens, et me proposa de former une section de vingt hommes, et ensuite, si je le pouvais, quatre autres sections, et qu’alors on me donnerait un drapeau. Lépine ajouta que la société avait à sa tête des chefs marquans, entre autres des princes polonais, et qu’il ne fallait qu’un coup de main pour établir la souveraineté du peuple ; que le gouvernement conspirait avec l’étranger, et que tous les décorés de juillet seraient perdus. Le vendredi d’avant les événemens, nous allâmes promener au Jardin des Plantes. Lépine remit à Poirel une carte de centurion de l’Association gauloise, et à moi des cartes de décurions. Les choses ne pouvaient pas durer ainsi, continua-t-il ; la poire est mûre, il faut en finir. Il faut que vous preniez du service. Mais, lui dis-je, j’ai une mère, une femme et des enfans ; je ne pourrais pas être au service. C’est égal, m’a-t-il dit, vous serez commissaire de police (on rit). La veille du convoi du général Lamarque ; Lépine m’a conduit chez un nommé Butte qui était aussi de l’Association gauloise. Chemin faisant, il m’a donné quelque chose de lourd que j’ai mis dans ma poche ; c’étaient des cartouches et des balles. C’est demain le grand coup : nous avons réussi à obtenir que le convoi passe par le boulevard, où d’abord il ne devait point passer. Lorsqu’on sera à la place de la Bastille, la république sera proclamée. Ayez soin de vous munir d’une épinglette et de deux pierres à fusil. Ayez l’œil sur moi ; dès que vous me verrez porter la main à mon fusil, vous ferez comme moi : l’affaire sera bientôt faite. Nous avons pour nous la garde nationale et la ligne ; il n’y a que les dragons et la garde municipale que nous n’avons pu séduire… » (19)
Enfin une lettre de Marchand à Thiellement, lue au procès de ce dernier, illustre la détermination de la Société gauloise : « « Mon cher Thiellement, observe bien ce que je vais te dire, et suis les instructions que je vais te donner. Après demain, les obsèques du général Lamarque ont lieu ; les dernières instructions te parviendront demain soir. Tu dois les communiquer au rendez-vous. Préviens tout ton monde ; qu’il se trouve chacun sous leurs chefs respectifs sur le chemin du convoi, par les rues adjaçantes, afin qu’en passant ils puissent pénétrer dans la foule de droit ou de force. Quiconque manquera au rendez-vous sera regardé comme lâche et traître. Tu comprends qu’il ne faut pas leur dire que c’est fait pour se battre. Il faut y aller sans armes, ou du moins cachées ; seulement avoir chacun le plus de cartouches possible et une pierre à fusil et une épinglette. Demain, tu iras chez M. Chassang lui communiquer les mêmes ordres ; tu recevras par Jacquel de nouveaux ordres de ma part. Ne manque pas. Adieu. Marchand. » (20)
Capo de Feuillide, un bourgeois progressiste, médaillé de Juillet, prétendit plus tard avoir fait parti d’un groupe de trois insurgés désignés par le sort pour tirer au pistolet sur la troupe (21). Même si nous savions qu’il avait fait partie de la Société gauloise, faudrait-il le croire ? Ne s’est-il pas vanté rétrospectivement ?
Quelle qu’ait été l’origine des premiers coups de feu le déclenchement des hostilités entraîna les républicains des différents quartiers, les uns préparés au combat, les autres improvisant.
Bon travail de votre côté
Pierre Baudrier
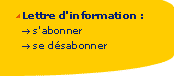


![]()
![]()




