Un dimanche au bord de l’eau
Escale à Saint-Valery, la belle cité balnéaire. A nouveau, ce rendez-vous avec les paysages de la Baie. Immédiatement, la promenade s’impose de manière évidente. La ville est faite pour ces déambulations oiseuses.
 D’humeur vagabonde, j’atteins la longue digue bordant le chenal lumineux. De frêles esquifs, voilure déployée, défilent devant mes yeux. Je tiens sous le regard l’horizon, le ballet des barques colorées, balançant leur quille au bout des amarres. Alors que le ciel puissant imprime ses reflets nacrés, la Baie offre ses étendues renouvelées, virginales.
Silence, magie des images, envoûtement. Les lieux inspirent, donnent à voir et à engranger, susurrent mille histoires. Des passants sans souci, nonchalants, viennent accomplir d’innocents rituels, admirent les gradations de couleur, numérisent des scènes marines. Ils me font penser à Cora et Bernard, les amants des « Rives Incertaines » de Robert Mallet, lorsqu’ils contemplaient le jeu des lumières, le remue ménage des eaux sur les frontières indécises, sur l’espace de concession et de partage, inlassablement libéré ou repris. La mer ici se fait artiste, pétrit, sculpte, esquisse des rivières serpentines, étale son camaïeu d’ocre. Mais la Baie, bien que prodigue, ne se livre pas docilement. Il faut être patient comme le pêcheur à pied, insouciant comme le rêveur de grèves, attendre les offrandes, être à l’unisson de la respiration des lieux.
D’humeur vagabonde, j’atteins la longue digue bordant le chenal lumineux. De frêles esquifs, voilure déployée, défilent devant mes yeux. Je tiens sous le regard l’horizon, le ballet des barques colorées, balançant leur quille au bout des amarres. Alors que le ciel puissant imprime ses reflets nacrés, la Baie offre ses étendues renouvelées, virginales.
Silence, magie des images, envoûtement. Les lieux inspirent, donnent à voir et à engranger, susurrent mille histoires. Des passants sans souci, nonchalants, viennent accomplir d’innocents rituels, admirent les gradations de couleur, numérisent des scènes marines. Ils me font penser à Cora et Bernard, les amants des « Rives Incertaines » de Robert Mallet, lorsqu’ils contemplaient le jeu des lumières, le remue ménage des eaux sur les frontières indécises, sur l’espace de concession et de partage, inlassablement libéré ou repris. La mer ici se fait artiste, pétrit, sculpte, esquisse des rivières serpentines, étale son camaïeu d’ocre. Mais la Baie, bien que prodigue, ne se livre pas docilement. Il faut être patient comme le pêcheur à pied, insouciant comme le rêveur de grèves, attendre les offrandes, être à l’unisson de la respiration des lieux.

Je pousse ma vague nostalgie jusqu’à l’antique tour d’Harold. J’enregistre, en passant, de belles images : le chenal opalin, les ors du Crotoy, des promeneurs alanguis, des vieux en tenue de matelot, une couvée de cyclistes, des mouettes rieuses, le relais emblématique, les demeures cossues à l’envi et ornées de balcons en bois, les vieilles murailles chapeautées par l’église Saint-Martin, enfin le sémaphore au bout de la ligne droite.
Je fais une halte dans une des buvettes qui bordent le chenal. De l’intérieur le ciel a l’air plus bleu, les nuageux plus crémeux, à vous tenter la main. Quant à ces kayaks colorés, échoués sur la grève, j’aurais voulu leur ajouter deux ou trois palmiers penchés sur le sable.

Un peu plus tard, sur les remparts, à l’image de ce vieux couple assis sur des chaises de camping ou de cet homme au chien, je me surprends à scruter des motifs familiers : les contours vert sombre du Marquenterre, les arabesques du sable, les lacs oblongs. La même attirance, le même mimétisme des regards. L’essentiel est devant soi, ailleurs. Un voilier passe. Son sillage retient les regards, fertilise l’imaginaire. Je songe à toutes les scènes marines, aux départs vers les mers inconnues, à l’armada de Guillaume le Bâtard, aux« milles voiles » du chroniqueur Malte-Brun, « portant les cent mille combattants », je revois les gribanes, les radeaux chargés de galets, les sauterelliers poussés par le noroît, les bateaux au long court se taillant la route à travers le chenal.

Mais dans ce pays tout est retour aussi. Je sors, de mon album jauni, de vieilles balades, dans le Courtgain des pêcheurs, le long des modestes maisons de pêcheurs aux tons pastel, qu’un certain Anatole France avait aimées dans ses « Promenades de Pierre Nozière en France »
« Le Courtgain s’étend derrière la rue de la Ferté, sur une rampe assez rude. Des maisonnettes, qui auraient l’air de joujoux si elles étaient plus fraîches, se pressent les unes contre les autres, sans doute pour n’être point emportées par le vent. Là, on voit à toutes les portes de jolies têtes barbouillées d’enfants, et çà et là, au soleil, un vieillard qui raccommode un chalut, ou une femme qui coud à la fenêtre derrière un pot de géranium. »
Je descends par des ruelles plus obscures et débouche sur l’avenue Romain Michel. J’ai l’espoir un peu vain de respirer les parfums fanés. Je feuillette des vieux souvenirs, cherche à retrouver les petits bonheurs de rien du tout, enfouis sous les gravats de la maison de l’Argentin.
Mais le train n’attend pas. De joyeux touristes, appareils photos en bandoulière, embarquent dans les compartiments propres comme des sous neufs. La belle locomotive, trépigne, envoie ses coups stridents. Le joyeux tortillard s’ébroue. Des passagers, sur la passerelle observent l’entrelacs des mâts et des cordages, envient les goélands qui prennent le large. Travelling arrière, la digue, ponctuée d’arbres et de marcheurs du dimanche, s’étire depuis la pointe du minuscule phare jusqu’à l’écluse. Les coeurs s’attendrissent devant les moutons paissant dans les étendues herbeuses. Les yeux s’égarent à travers les Mollières et le long des prés salés. Un cormoran au plumage sombre décrit une trajectoire énigmatique. Les voyageurs se taisent, se sentent loin de tout ; le temps glisse limpide, comme le sable dans la main. Puis soudain la page se tourne. Le songe s’en va. Le Crotoy se profile à l’horizon.
La cité rivale semble se lover comme un lézard le long du rivage minéral. Les touristes sont accueillis au petit port de pêche dans une ambiance de fête foraine. Sur l’estacade en bois, on espère le retour des flots. De vieux chalutiers tenus en laisse ont l’air d’attendre aussi. Près du port, des badauds se mêlent à la population locale. Les gens d’ici, on le sait, connaissent les tours des poissons, à en juger la richesse des étals exposés en plein vent. Des ménagères occasionnelles scrutent les Bouchots du pays, palpent les Oreilles de Cochon, croquent les Salicornes. Non loin de là, sur la place Jeanne d’Arc, c’est l’heure des songes, des bras enlacés, des cous appuyés sur les épaules des hommes ; seuls quelques claquements de boules viennent interrompre la douce rêverie. Aux terrasses des brasseries, le temps est suspendu ; des habitués du dimanche, des gens en escale et venus d’ailleurs lisent, se parlent, s’observent derrière leurs lunettes de soleil, se mettent en scène.
Je prolonge la parenthèse, le long des rues aux maisons basses, des hôtels à tourelles, poursuis la promenade côté rivage. Au moment des siestes, la plage semble sans ombre, la mer absente. Des promeneurs, les sens aiguisés, s’égrènent sur la vaste étendue de sable. Des pèlerins et leurs chiens s’aventurent dans le désert, vers les vagues lointaines. Le spectacle se prolonge à l’ombre des vieux remparts, des maisons anglo-normandes, l’après-midi s’étire sur une terrasse chaude.

Puis vient le soir. Le soleil décline derrière quelques nuages. J’assiste encore une fois à la cérémonie du large. La chance sourit parfois aux obstinés. Le contre-jour révèle les reflets dorés d’une mer qui semble inaccessible. Des pêcheurs à pied, intrépides, détachent leurs sombres contours sur un manteau légèrement rosé. Finalement, le soleil disparaît derrière la ligne d’horizon, emportant avec lui les silhouettes. Transition magique. Le rose orangé et le ruban d’or capitulent. Brève rivalité entre la nuit et le jour. Renaissance des couleurs diaphanes, des reflets livides. Instants de mélancolie. Je sors l’appareil photo, pour de nouvelles aventures chromatiques. La nuit est tombée sur les lumières du long quai de l’Aviation.
Silencieux, je repars d’où je suis venu. Des voix étouffées se réveillent, fragiles, comme des porcelaines sorties du Titanic.
« La baie de Somme, humide encore, mire sombrement un ciel égyptien, framboise, turquoise et cendre verte. La mer est partie si loin qu’elle ne viendra peut-être plus jamais ?…Si, elle reviendra traîtresse et furtive comme je la connais ici… »
« Les Vrilles de la Vigne » Colette (Livre de Poche).

Texte et photos David DELANNOY
Ecrivain-marcheur.
Auteur de Lectures Buissonnières (Editions La Vague Verte) et de Picardie Vagabonde (éditions Punch - 30 textes illustrés d’aquarelles de Roger Noyon et de
Jean-Marc Agricola).
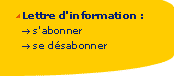

![]()
![]()









