Au bout de l’ancienne voie ferrée, j’atteins Guise, par une belle soirée de Juillet.
Guise, « le gué sur l’Oise », l’expression suffit à féconder l’imaginaire.
J’ai, devant mes yeux, le fort dominant la ville, sur une butte luxuriante.
 Sa tour cylindrique aimante le regard, en impose avec ses restes de remparts, que l’on devine sous l’épais fouillis de la végétation. La « Pucelle » jamais prise… l’ultime poste de garde, posé dérisoirement pour le décor.
Sa tour cylindrique aimante le regard, en impose avec ses restes de remparts, que l’on devine sous l’épais fouillis de la végétation. La « Pucelle » jamais prise… l’ultime poste de garde, posé dérisoirement pour le décor.
Je rassemble, vaille que vaille, mes maigres connaissances sur l’ancien oppidum, fortifié de palissades, devenu château féodal, au fil des siècles, puis citadelle militaire. Sa position privilégiée, sur un coude de la rivière, avait fini par décourager les assaillants, venus du Nord.
Ses glorieux possesseurs ont laissé aussi dans ma mémoire de vagues empreintes, des souvenirs de complots, d’assassinats.
Une ceinture de briques, construite par les hommes de Vauban, vient étayer l’ensemble. Vue d’en bas, et sous l’épais feuillage, il est difficile de s’en faire une idée précise.
Ce soir, dans la chambrée de l’Hôtel du Commerce, j’irai glaner quelques souvenirs dans le livret jauni, épuisé (j’avais acheté le dernier exemplaire de monsieur Pierdé à l’Office de Tourisme… histoire de ne pas m’endormir idiot.
Le faubourg
Je progresse dans un quartier ouvrier, après avoir coupé la route de Saint-Quentin. L’ombre déjà s’est installée sur un square sans âme, sur un quartier aux rues mélancoliques.
La rue de Robbé et celle d’André Godin, interminables.
Le cadre, tout droit surgi d’un roman de René Fallet.
Ici et là, les couleurs du désœuvrement.
Des maisons mitoyennes, aux façades noircies, s’alignent le long du contrefort crayeux ; une fenêtre, une porte, une fenêtre, une porte … motifs alignés à l’identique, où seuls les rideaux et les teintes des volets affichent une illusoire différence. Certaines sont condamnées à l’usure, avec leurs portes et fenêtres murées par des parpaings. D’autres quelquefois, sont recouvertes d’une peinture blanche, pour cacher la misère.
Partout, la brique, sombre et salie, donnant la tonalité majeure de la cité, avec une connotation vaguement britannique.
Au seuil des foyers, quelques hommes s’abandonnent au temps qui passe.
Parfois encore, l’intimité vous est offerte sans pudeur, derrière un landau, celle d’une radio entonnant un rap de banlieue, monotone.
Au bout du long cheminement, j’entrevois enfin l’éclaircie, comme une joie imprévue.
Le pavillon Cambrai - le plus récent des bâtiments construits par l’utopiste Jean-Baptiste-André Godin - m’apparaît soudain, comme un ensemble plus jovial, malgré l’austérité du revêtement.
J’avais eu raison de ne pas enterrer trop vite la ville, à la morosité de surface.
Un peu plus loin, il y a cette porte symbolique, levant définitivement les doutes et s’ouvrant sur l’univers de l’ancien capitaine d’industrie.
« Je fonderai au milieu de vous l’œuvre dont le monde entier se préoccupera avant 50 ans. Qu’elle ait duré jusque-là, ou qu’elle soit tombée hélas ! faute d’homme, fût-elle même détruite de fond en comble et le terrain rasé à la place du Familistère, qu’elle renaîtrait vivante du fond des souvenirs et serait rétablie de toutes pièces car la pensée est impérissable. »
Jean-Baptiste André Godin, Conférence au personnel, 6 Avril 1878.
Des immeubles imposants et homogènes, surgis du 19e siècle ; le Pavillon Central, flanqué de ses ailes presque jumelles, le belvédère au-dessus des toits, un vieux théâtre en face, et des locaux annexes, construits sur le même ton.
D’emblée, je sens la charge particulière, la gravité peu ordinaire, les protections intimes.
 Le soleil couchant vient égayer la façade principale, les briques s’illuminent subitement, rappellent vaguement une description, tirée de l’oeuvre d’Emile Zola, Travail.
Le soleil couchant vient égayer la façade principale, les briques s’illuminent subitement, rappellent vaguement une description, tirée de l’oeuvre d’Emile Zola, Travail.
L’auteur - je l’apprendrai un peu plus tard - a pris des notes sur Guise, sur la grande aventure du Familistère, pour mieux installer son chef d’entreprise, Luc Froment, pâle copie du bâtisseur, de l’industriel ébloui par Fourier.
Il fallait du « grain à moudre », pour raconter l’accomplissement d’un rêve, la fondation d’une cité nouvelle, le sauvetage de miséreux, extirpés de l’enfer des taudis, la bataille contre les mesquineries des hommes.
« Dès lors, Luc le constructeur, le fondateur de ville, se retrouva, voulut, agit, et les hommes et les pierres se levèrent à sa voix. On vit l’apôtre dans sa mission, dans sa force, dans sa gaieté » (Travail, Emile Zola).
Sur son piédestal, Monsieur Godin, l’ultime témoin d’un monde englouti, défend l’entrée de l’immeuble connu des historiens, sous le vocable de "Familistère".
Je suis frappé par l’impression de solidité du personnage, dressé là, envers et contre tout, comme un rocher inexpugnable, prêt à défendre son univers de briques, à convaincre les êtres de bonne volonté, de la justesse de son point de vue, de la légitime ambition de vouloir répartir, les équivalents de la richesse.
Avant que le soleil ne prenne ses quartiers de nuit, des touristes, reconnaissables à leur air fouineur, cherchent à prendre des photos de mémoire, à capter les jeux des gosses dans les coursives ou l’édifice, dans son embrasement final.
Quelques résidents émergent des balcons proéminents et clairs, toisent d’un coup d’œil ces oiseaux de passage.
Je m’interroge, brièvement, sur la signification des regards, cherche à en connaître les motifs… vague malaise, rancœur fermentée, je n’ai pas de réponses immédiates.
A l’entrée du pavillon de droite, des adolescents, obstinément groupés, comme les protagonistes d’un feuilleton américain, font comprendre clairement que vous êtes ici, en terre étrangère.
Pétarades de mobylettes, cris des enfants sous la verrière, qui investissent l’espace bruyamment, sans vergogne, comme des bretteurs.
Je pousse en avant une porte aux battants abîmés. Ceux-ci se referment derrière moi, sans ménagement, me livrent un monde clos mais aéré, une cour fermée et rectangulaire, éclairée d’une vaste verrière. Sur trois niveaux, des coursives protégées d’une balustrade relient les appartements. Certains ont l’air d’être fraîchement réhabilités.
C’est propre, net sur le carrelage en terre cuite. Les balcons intérieurs désertés sont remplis du bruit des télés, des cris des enfants. Tout cela vous monte aux oreilles, de manière amplifiée.
La qualité de l’éclairage, à l’heure vespérale, me frappe, donne l’envie de photographier la couleur miel des murs, les coulées roses des Pélargoniums, les volumes, les lignes de fuite des rambardes, les rondeurs des larges escaliers situés à chaque angle, ce jeu kaléidoscopique d’ombres et de lumières, diffusé sur le sol.
 Je n’ose pas, je suis le fraudeur, le colporteur qu’on attend pas.
Les gens d’ici, semblent figés dans leur cloisonnement « intérieur ». Je les devine derrière les portes closes. Je les imagine hostiles à toute idée de changement, se moquant de l’héritage culturel et prêts à enduire les murs d’un crépi salutaire. Des locataires, contraints d’assister au ballet des touristes furetant dans les coulisses, incités à devenir les spectateurs d’eux-mêmes.
Je n’ose pas, je suis le fraudeur, le colporteur qu’on attend pas.
Les gens d’ici, semblent figés dans leur cloisonnement « intérieur ». Je les devine derrière les portes closes. Je les imagine hostiles à toute idée de changement, se moquant de l’héritage culturel et prêts à enduire les murs d’un crépi salutaire. Des locataires, contraints d’assister au ballet des touristes furetant dans les coulisses, incités à devenir les spectateurs d’eux-mêmes.
Dans les galeries menant aux caves, tout se rouille, se craquelle sous l’effet de l’humidité, tout se délite sous l’action du temps.
Vague nausée. Les battants de la porte m’expulsent vers l’extérieur.
Poussé par une malsaine curiosité, je tente l’exploration du parc, situé à l’arrière.
L’envers du décor est moins glorieux et plus négligé.
Une pelouse haute, du linge pendu aux quatre vents et une carcasse de voiture confèrent à l’endroit des faux airs de banlieue. Un peu à l’écart, je remarque le kiosque, construit après la mort du « capitaine » pour adoucir l’existence et vous écarter du chemin de l’estaminet.
Sur les fenêtres, fleurissent des affiches hostiles au projet de réhabilitation du Familistère. C’est flagrant, on ne veut pas, ici, d’« Utopia » ni des expulsions. J’en tire de hâtives conclusions, fais des rapprochements avec le passé… étrange décalage.
Le "Palais", que l’on dit "Social", n’identifie plus forcément tous ceux qui, désormais, l’habitent.
Je pense au promoteur originel, à celui qui avait établi les règles de résidence et voulu le bonheur de ses congénères, parfois malgré eux, en les dotant de toutes les commodités, si banales de nos jours, si rares au 19e siècle, au prix de règles de vie rigoureuses et cadrées… l’hygiène, la tempérance, les vertus cardinales au forceps. L’envie aussi de favoriser les liens dans les coursives joyeuses, dans les couloirs reliant les pavillons.
Je m’interroge vaguement sur la manière de sceller la réconciliation des deux mondes, aux enjeux différents. Peut-on blâmer, pourtant, ceux qui souhaitent voir la fin des dégradations.
Le jour commence à baisser, les ombres s’allongent. Méfiance palpable derrière les rideaux. L’endroit m’apparaît soudain lugubre. Les échos des enfants, dans le hall intérieur, se sont tus. Au bout de l’allée, ombragée de majestueux marronniers, un bras de l’Oise vient mourir dans une impasse.
Le touriste s’en va, la vie continue.
L’Hôtel du Commerce
J’ai envie d’ajouter de sombre mémoire, pour rappeler les désagréments de Victor Hugo, lors de son étape à l’auberge de « La Hure » à Laon. Le fricot frelaté avait mis en colère notre voyageur, au point de le rendre acrimonieux à l’encontre de l’aubergiste et des usagers,"aux faces stupides et campagnardes".
« Vendeur de fricot frelaté,
Hôtelier chez qui se fricasse
L’ordure avec la saleté,
Gargotier chez qui l’on ramasse
Soupe maigre et vaisselle grasse
Et tous les poux de la cité… »
Je n’ai pas bien sûr la rancune aussi tenace.
Ni la viande altérée, ni la chambre lugubre ne viendront ternir les bons souvenirs et la réputation de l’aubergiste…
Près du comptoir, des habitués jouent à un jeu obscur ; ils lancent, sur le sol, des plaques arrondies en fer pour les rapprocher d’un palet plus petit.
Un jeu de pétanque pour « piliers de bistrots », plus proche des coups à boire.
Le lendemain matin, réveil agile, je m’extirpe de l’auberge maudite, prêt à m’atteler au programme chargé, à respecter scrupuleusement les consignes de mon sujet.
J’ai passé en revue l’œuvre géniale du marchand de poêles, arpenté les rues aux « boutiques obscures », poursuivi ma quête, par une ruelle moyenâgeuse, jusqu’au puissant donjon. Notes griffonnées et jeux de plume pour ne pas oublier, suffisantes pour dire combien Guise, sous ses faux airs de banlieue industrielle, est attachante, pleine d’histoires à distiller, qu’elle cache bien son jeu. Rien n’est désespérant, il en suffit de peu pour que les gargotes deviennent de belles résidences hôtelières, capables de retenir les passants.
 Devant le « parvis », le Familistère m’apparaît sous ses meilleurs traits. Sans doute le soleil levant. Il exhale, comme malgré lui, la nostalgie d’un monde englouti.
L’appartement témoin ; je jette quelques adjectifs.
Coquet, intime et presque lumineux.
L’espace d’un moment, je suis l’enfant de la maison.
Hors du temps.
Endroit peu ordinaire, curieusement familier.
Souvenirs de soupes chaudes, de pâtées, de gaufres fourrées et flamandes.
Odeurs de fricots, montant aux narines.
Des objets anciens vous parlent du temps pas si lointain.
Rengaines, fredonnées autour du poêle fétiche.
Raies de lumière brillantes, venues du dehors, braquées sur l’antique couche…
Devant le « parvis », le Familistère m’apparaît sous ses meilleurs traits. Sans doute le soleil levant. Il exhale, comme malgré lui, la nostalgie d’un monde englouti.
L’appartement témoin ; je jette quelques adjectifs.
Coquet, intime et presque lumineux.
L’espace d’un moment, je suis l’enfant de la maison.
Hors du temps.
Endroit peu ordinaire, curieusement familier.
Souvenirs de soupes chaudes, de pâtées, de gaufres fourrées et flamandes.
Odeurs de fricots, montant aux narines.
Des objets anciens vous parlent du temps pas si lointain.
Rengaines, fredonnées autour du poêle fétiche.
Raies de lumière brillantes, venues du dehors, braquées sur l’antique couche…
Vous vous dites que Godin, sacré bonhomme, n’a rien en commun avec les industriels de son époque, pour qui les logements devaient être chichement mesurés, mesquins, juste des abris noirs, alignés uniformément, pour entasser les existences, à l’ombre des terrils, des cheminées.
Je pense à tout cela, aux grandes demeures des seigneurs, de l’ère industrielle naissante, dans leur écrin de verdure, grandiloquentes, pour imposer le respect et à monsieur Godin, dans son « chez lui » douillet, parmi les siens.
De sa fenêtre, dans l’appartement reconstitué à l’identique, je vois ce qu’il a probablement vu. Perception immédiate de la place, du théâtre, de l’école, de l’économat, de l’aile gauche avec sa toiture aux tuiles vernissées. L’œuvre mise en scène, mise en lumière, en une synthèse parfaite. Fenêtre ouverte, aussi, sur la vie extérieure, sur la ville soupçonneuse, sur le décor familier du donjon, dressé sur le vieil Oppidum romain ; sur cette belle posture, au milieu des feuillages.
Espace, intime, offert au regard du bon génie ; je ressens la pesanteur du lieu.
Suite : ici.
David.Delannoy@ac-amiens.fr.
Ecrivain-marcheur.
Auteur de Lectures Buissonnières (Editions La Vague Verte) et de Picardie Vagabonde (éditions Punch - 30 textes illustrés d’aquarelles de Roger Noyon et de
Jean-Marc Agricola).
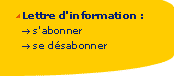

![]()
![]()







